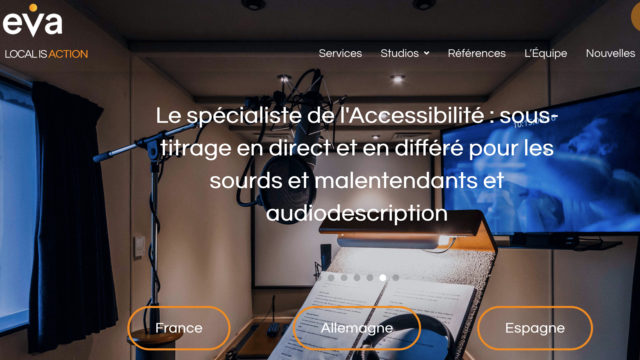Avec l’exigence de qualité qui se développe aujourd’hui – d’analogique en numérique, de 2K en 4K, de SD en HD et bientôt UHD – la restauration d’images se développe au point de devenir un phénomène de mode, avec de nombreux festivals, comme « Cannes Classics » ou « Toute la mémoire du monde » de la Cinémathèque Française. Les ayants droit qui ont investi se retrouvent avec des copies neuves, dans une qualité qu’on n’espérait plus, et offrent aux spectateurs de découvrir des œuvres anciennes dans d’excellentes conditions.
Les défauts à traiter
Les problèmes sont différents selon l’original. Sur pellicule, on rencontre des défauts transitoires – les poussières, les taches, les moisissures, les bactéries, les défauts de collure, les images brûlées – et d’autres qui courent sur plusieurs images – les poils caméra ou scanner, les rayures, les déformations du support, les instabilités verticales et/ou horizontales, les battements d’image (flicker). Bien souvent le grain n’est pas homogène et il faut soit le réduire, soit l’augmenter, pour le faire correspondre d’un plan à l’autre, voire entre différentes zones d’une même image. Si l’on dispose du négatif original, il n’y a plus qu’à refaire l’étalonnage du film d’après les copies de l’époque ; si l’on dispose d’un inter, il est parfois nécessaire de corriger les décalages d’étalonnage (imprécision entre le déclenchement par l’encoche sur la pellicule et l’application des filtres).
Si l’original est en vidéo, on rencontrera des trous dans la couche magnétique (drop-outs), des décalages spatiaux ou temporels des canaux RVB, de la diaphotie (cross talk) entre la luminance et la chrominance, etc. Ici l’on cherchera souvent à réduire le bruit vidéo sans toutefois perdre le détail.
Les étapes
Le travail commence par un examen du ou des originaux : il est courant de ne disposer que d’une partie du négatif, et qu’il faille reconstruire la continuité d’un film avec des inters ou des copies d’origines diverses. On les numérise avec un scanner pour la pellicule, avec une carte d’acquisition pour les bandes analogiques.
Après avoir importé ces éléments dans le système de restauration, on procède à une détection de plans, par EDL si on en dispose, sinon par reconnaissance des ruptures dans l’image.
Dans toute correction, il faut distinguer deux étapes : d’abord la détection du problème – il y a un trou dans la pellicule par exemple – et ensuite sa résolution – interpolation spatiale utilisant les pixels voisins, ou temporelle allant chercher les images précédentes ou suivantes. L’une et l’autre se passent mieux avec une haute résolution et une grande profondeur, autrement dit le résultat sera meilleur avec un original 4K 16 bits, même si l’on doit terminer en 2K 10 bits. Évidemment le poids des fichiers n’est pas le même, et cela demandera davantage de ressources matérielles et financières.
En général, on commence par une passe automatique, le système de restauration se chargeant de reconnaître les défauts et de les corriger, mais ensuite une phase manuelle est évidemment nécessaire. L’opérateur dispose de divers outils, géométriques pour dessiner une zone à l’intérieur de laquelle le logiciel détecte le défaut automatiquement, mais aussi de brosses avec lesquelles il l’efface en dessinant par-dessus, parfois assisté par un suivi de mouvement (tracking).
Enfin, on prend garde à la cadence et au ratio de l’image pour qu’ils soient respectés sur le nouveau support.
Chez Digimage
Réunies autour d’un SAN, une station Phoenix (Digital Vision), deux stations Diamant-Film (HS-Art) et leur unité de calcul (render farm), communiquent entre elles et avec une station Correct (MTI). Un Clipster (DVS) sert de lecteur central pour alimenter les salles, aussi bien en vidéo qu’en 2K. L’étalonnage se fait sur un DaVinci Resolve (Blackmagic).
Pour la restauration des films de Jacques Demy (Les Parapluies de Cherbourg, Peau d’âne, Les Demoiselles de Rochefort etc.), le négatif original a été scanné en 2K 10 bits log, parfois 4K en vue d’une restauration future, mais aujourd’hui elle a été faite en 2K. Pour les Parapluies, Bruno Despas, directeur exploitation et développement, a eu la chance de disposer d’une séparation trichrome (l’image recopiée sur trois négatifs noir et blanc, respectivement filtrés en jaune, magenta, cyan), ce qui implique trois scans à réassocier ensuite.
Pour des films de Méliès où les négatifs n’existent plus, il a fallu récupérer des copies nitrate parfois peintes à la main. Le Scanity (DFT) est un scanner sans débiteurs ni griffes, avec un entraînement par cabestan, qui permet de traiter la pellicule malgré la taille non-standard des perforations.
On évite le dégrainage, jugé trop destructif, sauf quand se posent des problèmes de raccord – pour les films par exemple où les effets étaient encore montés cut, à l’intérieur du plan.
Bois d’Arcy
Les Archives du film, qui dépendent de la direction du patrimoine cinématographique du CNC, utilisent un scanner Director (LaserGraphics) et un autre construit selon leur propre cahier des charges. Cela permet de scanner tous les formats, depuis le 8 mm jusqu’au 90 mm, et en HDR, c’est-à-dire en trois passes de 18 bits chacune, pour tirer le meilleur de la dynamique originale de l’image. Le résultat est enregistré en 2K 10 bits log. Une analyse infrarouge mémorise les défauts mécaniques de la pellicule dans une couche alpha, qui est récupérée dans Diamant-Film.
Pour la série des documentaires de Joris Ivens, Comment Yukong déplaça les montagnes (1976), les négatifs 16 mm originaux étaient dans un assez bon état. Mais pour Tsogt taij, film mongolien de T. Khurlee (1945), il n’y avait qu’un contretype noir et blanc très abîmé, avec des taches recouvrant jusqu’au quart de l’image, des rayures et, parce qu’il s’agissait d’une copie, des poussières incrustées dans le contenu de l’image, ainsi qu’un grain important.
Les fonctions automatiques des trois stations Diamant-Film, combinées à une unité de calcul, ont été utilisées mais en les bridant : on préfère, par respect pour l’œuvre originale, laisser passer quelques défauts plutôt que d’ajouter des artefacts.
L’étalonnage est fait à l’extérieur (Digimage, Éclair…), et si de nouveaux défauts apparaissent à ce stade, on retourne à Bois d’Arcy corriger les originaux.
Nicolas Ricordel, responsable des archives, dit avoir testé Phoenix et se prépare à examiner PFClean (The Pixel Farm). Au-delà des questions qualitatives, le choix portera pour une grande part sur l’ergonomie des outils.
L’Africain chez Technicolor
Pour la restauration de L’Africain de Philippe de Broca (1983), Pathé a demandé au chef opérateur Pierre Lhomme de suivre le travail. Deux scans ont été faits, l’un en 4K 16 bits stocké sur LTO pour une exploitation ultérieure, le second, en 2K 16 bits, utilisé pour des diffusions 35 mm, DCP 2K, et HD. Ici le choix fut de restaurer d’abord et de ré-étalonner ensuite.
Le négatif 35 mm était mécaniquement propre – pas de problème de perforations ni de collures à refaire – mais en 2,35 anamorphosé, donc avec un espace interimage très petit (la raison qui avait conduit à la modification du scope de 2,35 en 2,39), et il a fallu retoucher toutes les collures.
Technicolor dispose de deux postes Diamant-Film et, plutôt que de travailler plan par plan en cherchant tout de suite un résultat final, ils ont opéré par passes, afin de juger au fur et à mesure de l’avancement.
Un premier traitement automatique a corrigé les collures (splice repair) et a supprimé les poussières (dust bust), de taille limitée (2 ou 3 pixels) mais avec une amplitude de luminance importante. Le but recherché était d’automatiser la suppression des petits défauts, même très proches de l’image, difficiles à détecter à l’œil, mais sans aller trop loin pour ne pas ensuite devoir corriger les erreurs de la correction automatique. La passe manuelle ne fut pas facile sur une image non-étalonnée.
Les fichiers ont été calculés, puis un premier étalonnage a été fait sur Scratch (Assimilate) avec visualisation sur écran de 6 mètres, ce qui évidemment a fait apparaître de nouveaux défauts. Pour les corriger, le travail a été repris là où il avait été laissé dans le Restoration Manager (HS-Art) – l’organisation par couches permet de revenir facilement à une étape antérieure – et, en se guidant avec le rapport fait lors de l’étalonnage, de nouvelles corrections ont été appliquées. Pour simuler le travail d’étalonnage, des LUT ont été appliquées.
Enfin le dégrainage a été fait sur Clarity (Digital Vision) : une version non dégrainée pour le retour 35 mm ; une autre légèrement dégrainée pour la HD ; et une dernière, un peu plus poussée, pour le DCP.
Aux laboratoires Éclair
Rien ne se fait avant un examen poussé des éléments d’origine : essuyage, renforcement des collures, consolidation des perforations… Les films répartis sur de petites longueurs, comme La Fièvre monte à El Pao de Luis Buñuel (1959) qui était sur 11 bobines de 300 m, demandent davantage de travail, car ce sont toujours les extrémités, tête et pied, qui souffrent le plus.
On cherche à tirer le meilleur du négatif, mais si une image y est irrécupérable, on préfère aller la rechercher sur un inter, par exemple, donc avec une définition légèrement plus faible, plutôt que d’interpoler et de créer une image qui n’existait pas dans l’original.
Le scan se fait souvent en 10 bits log et en « 4,5 K », c’est-à-dire en 4872 × 3248 (au lieu de 4096 × 3112), de façon à inclure les manchettes de la pellicule dont on garde ainsi la trace dans l’archivage. Il se fait entre autres sur un scan Nitroscan (développement interne) avec un aquarium gate (boîte étanche dans laquelle passe le film) qui supprime déjà un grand nombre de défauts. Puis le scan est vérifié à son tour, quant à son homogénéité, sa sensitométrie etc.
Un premier traitement semi-automatique est appliqué sur un Phoenix Refine pour retirer les poussières les plus petites, les moins gênantes, et la restauration se poursuit manuellement sur un Correct. Les défauts sont classés sur une échelle de 1 à 3, correspondant à la gêne pour le spectateur et, d’autre part, sur une échelle de 1 à 5 représentant la difficulté à les corriger. Et, ainsi que le remarque Charlotte Quémy, responsable de l’atelier de restauration numérique, les défauts les plus gênants ne sont pas forcément les plus compliqués à corriger, et inversement.
Puis, selon les besoins, comme la correction de moisissures qui est particulièrement délicate, sont utilisés toutes sortes d’outils, dont une batterie de Flame, Flare, Inferno (Autodesk), un DaVinci Revival… Le matériel est choisi spécifiquement pour chaque film, non seulement pour ses capacités, mais aussi pour son ergonomie et sa facilité d’exploitation. En général, on ne corrige pas les défauts de tournage (ombre de perche, battements dus à l’éclairage de l’époque…), sauf si le client le réclame.
La restauration est menée de front avec l’étalonnage, sans que jamais ils soient fondus l’un dans l’autre, car on conserve jusqu’à la fin une version non-étalonnée.
Les films sont archivés en 4K (scan brut), mais pour le DCP, la plupart sont ramenés en 2K. Quelques-uns seulement (Les Enfants du Paradis, Tess, L’Ours…) auront une exploitation 4K. Enfin, quand le budget le permet, la restauration est reportée sur film pour une meilleure conservation.
Le coût
Au total, selon Pierre Boustouller, Directeur Commercial Patrimoine chez Éclair, la restauration d’un film demande entre quelques centaines et plusieurs milliers d’heures de travail, soit un coût entre une dizaine et une centaine de milliers d’euros. Tout dépend de l’état de l’original, des exigences quant au travail de restauration et d’étalonnage, lesquelles sont souvent aussi fonction des perspectives de diffusion. On comprend qu’un laboratoire, quand on vient leur demander un devis, puisse être embarrassé : avant d’avoir examiné les éléments et, surtout, avant le scan, il est difficile de prévoir le volume de travail nécessaire.